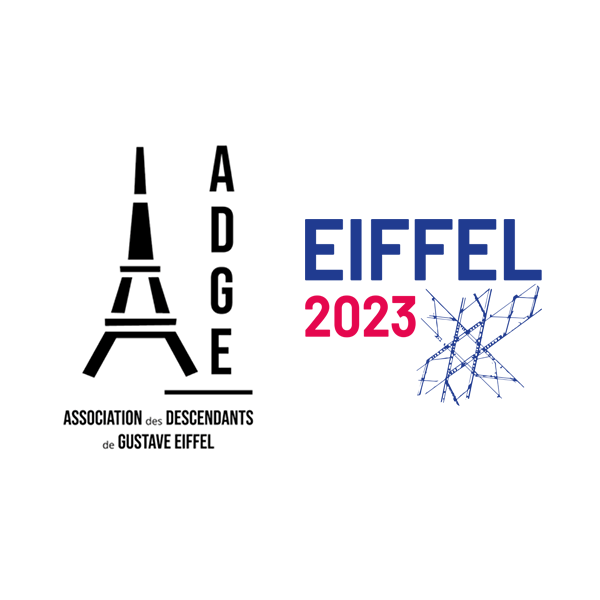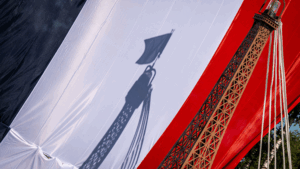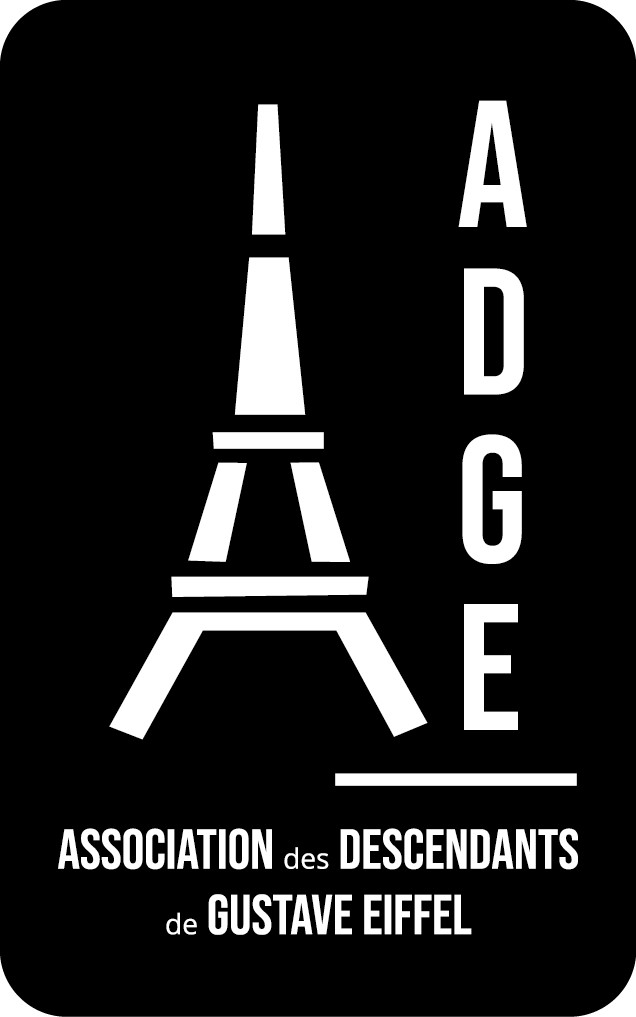Visiter le viaduc de Garabit en ayant la chance de pouvoir pénétrer à l’intérieur de la structure restera une expérience inoubliable pour ceux qui se sont donné la peine de participer au voyage d’études organisé par l’Association des descendants de Gustave Eiffel durant le week-end des 15 et 16 mars 2003 pour visiter les viaducs de Garabit et de Rouzat construits par notre aïeul près de Clermont-Ferrand.
Le viaduc de Garabit
Philippe Serey-Eiffel avait obtenu de la SNCF et du Réseau Ferré de France, que nous soyons reçu par Monsieur Méo, ingénieur responsable des ouvrages d’art de la région Auvergne.
Monsieur Méo nous a d’abord fait grimper sur le flanc de la base maçonnée du pilier sud en utilisant une longue échelle métallique et verticale pour atteindre le sommet de la pile en dur sur laquelle s’appuie la partie métallique. Puis nous avons cheminé à l’intérieur de l’arc parabolique en empruntant l’un des deux escaliers de service installés de part et d’autre de l’arc. Nous avons effectué l’ascension jusqu’au sommet de l’arc à peu près à 90 mètres de hauteur par rapport au niveau de la Truyère.
Ce furent des moments uniques, d’une rare émotion, d’une grande beauté, bien qu’assez angoissants. Malgré quelques appréhensions Dosithée Berthelot, Delphine Berthelot et Alain Touchard, Philippe et Raymonde Serey-Eiffel, Jérôme Yeatman, Sylvain et Evelyne Yeatman-Eiffel, sont parvenus à vaincre leur frayeur et à atteindre le sommet.
Nous avons ainsi mieux compris la difficulté de construction d’un tel ouvrage long de 561 mètres qui était à l’origine à 122 mètres de hauteur avant la construction d’un barrage sur la Truyère à 20 km en aval qui a remonté le niveau d’une quinzaine de mètres.
Nous avons ensuite traversé le viaduc sur le tablier en suivant la voie unique.
Gustave Eiffel décrit la construction du viaduc dans un mémoire publié en 1889 : « Au commencement des travaux, le pays aux abords était complètement désert, il a donc fallu commencer par construire les bureaux, les logements des ingénieurs et des ouvriers, les cantines et même créer une école pour les enfants des ouvriers. Nous avons ensuite exécuté un grand pont de service en charpente à 33 mètres de haut sur la Truyère, la tête de pont côté Marvejols a été raccordé à la route nationale par un chemin à flanc de coteau d’une faible longueur. C’est là qu’a été créé le dépôt des fers destinés à l’arc avec les grues roulantes pour le déchargement des charrettes qui apportaient les fers de la station de Neussargues après un trajet par route de 35 km en voitures à chevaux.
L’exécution des maçonneries et des piles métalliques n’a présenté rien de spécial. Simultanément on montait sur le plateau aux deux extrémités de l’ouvrage et sur les plates formes en remblai préparées à cet effet, les deux tabliers latéraux côté Marvejols et côté Neussargues. Ces tabliers furent ensuite lancés et amenés respectivement jusqu’aux grandes piles 4 et 5 où l’on a donné à chacun d’eux un porte à faux de 22,20 mètres du côté de l’arc. L’extrémité arrière de chaque tablier fut amarré à l’aide de 28 câbles en acier ancrés aux maçonneries des culées des viaducs d’accès. Cela fait on commença les préparatifs pour le levage de l’arche en installant des échafaudages en courbe de façon à former un cintre sur lesquels on établit les premières pièces des retombées des arcs, puis on rattachât l’extrémité de cette première partie de l’arc qui s’avance vers le vide à l’aide de 20 câbles en acier au tablier droit à l’aplomb de la grande pile. C’est alors que put commencer le montage de l’arc en porte à faux. On procédait par cheminement en rattachant les pièces nouvelles à celles qui étaient déjà assemblées et rivées et en installant de nouveau câbles d’amarrages dès que la partie montée en porte à faux se rapprochait de la partie inférieure qui lui faisait équilibre. La progression se faisait bien entendu simultanément des deux côtés de l’arc, les deux parties opposées s’élançant en même temps à la rencontre l’une de l’autre .
Le levage des pièces se faisait deux moyens distincts. Les pièces lourdes étaient amenées par un wagonnet, sur le pont de service à l’aplomb du point où elles devaient être élevées puis hissées par des treuils placés sur une grue fixée au sommet de l’arc extérieur. Pour les pièces légères, on avait élevé sur les grandes piles deux grands pylônes en charpente de 10 mètres de hauteur dont le sommet soutenait un câble porteur en acier franchissant l’espace de 177 mètres qui sépare ces piles. Sur ce câble roulaient deux chariots mobiles qui servaient au montage des pièces de faible poids, chacun des chariots desservant l’un des côtés de l’arc.
Les dispositions prises étaient telles que les deux parties d’arc qui devaient se rencontrer, se trouvaient toujours pendant le montage à une disposition légèrement supérieure à celles qu’elles devaient occuper définitivement de sorte que, pour régler les abouts des arcs pendant le cours du montage et les maintenir à leur vraie position dans l’espace, on a opéré une série de manoeuvres qui ont consisté à tendre successivement chaque câble pour relever l’ensemble de la quantité correspondant aux abaissements qui se produisaient pendant le montage.
Le 20 avril 1884 on a pu posé la clef d’intrados sans avoir aucune retouche à faire. Toute l’opération s’est bornée à abaisser légèrement les deux parties de l’arc jusqu’à ce que l’on arrive au complet contact. La pose de la clef d’extrados se fit le 26 avril 1884.
La construction du reste de la ligne étant en retard, l’inauguration du viaduc ne se fit que le 10 novembre 1888.
Le viaduc de Garabit ayant été inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a décidé de valoriser l’ouvrage dans le site en choisissant la couleur rouge Gauguin lors de la dernière campagne de peinture réalisée entre 1992 et 1998 dont le budget de 13,2MF a été partagé entre la SNCF, la DRAC et l’Etat. 80 tonnes de peinture à base de résines époxy et de polyuréthane ont été utilisées en remplacement du minium de plomb qui est désormais interdit.
Les viaducs de la Sioule et de Neuvial
Gustave Eiffel a créé sa propre société de construction métallique à Levallois à l’automne 1866. Ses premières réalisation sont les ossatures en fer et fonte de la synagogue de la rue des Tournelles et des églises Notre Dame des Champs et Saint Joseph à Paris. Il réalise 42 petits ponts sur la ligne Poitiers-Limoges. Il réalise la couverture du pavillon des Beaux Arts pour l’exposition Internationnales de 1867 à Paris et il obtient enfin sa première grosse commande via Wilhem Nordling, ingénieur en chef de la Cie Paris-Orléans. Il s’agit des viaducs de la Sioule appelé aussi Rouzat d’une longueur de 180 mètres à 59 mètres de hauteur et de Neuvial long de 160 mètres à 44 mètres de hauteur, entre Commentry et Gannat.
Il écrit à sa mère : « C’est pour moi un double succès, d’amour propre d’abord, et en outre de travaux importants et tout à fait de nature à me poser de suite parmi les maisons qui comptent. Cela me fait d’assurer environ 800 000 francs de travaux soit un an et demi de sécurité. »
Pour la réalisation de ces viaducs Gustave Eiffel inaugure une nouvelle technique de construction, celle du lançage en porte à faux, utilisant un système de chassis à bascule qu’il a breveté. Le tablier en treillis est construit sur le terre plein prolongeant la voie puis poussé dans le vide sur des rouleaux en fer auxquels on imprime un mouvement de rotation à l’aide de grands leviers en bois armés de cliquets. Le pont s’avance dans le vide, retenu horizontal par le contre poids de la partie du tablier resté sur la terre ferme. Quand le pont est parvenu à l’aplomb de la pile future dont le socle en maçonnerie est seul préparé au sol, il devient l’engin de construction de la pile qui doit le soutenir grâce à une grue placée à l’extrêmité du tablier
La pile s’élève jusqu’à sa hauteur définitive et l’on pousse alors le tablier sur le sommet de la pile qu’il vient de construire. Une opération semblable se renouvelle pour toutes les piles suivantes jusqu’à atteindre la culée opposée. Les arrêtes des piles sont incurvées à la base pour servir de jambes de force contre le basculement, elles dont réalisées en tubes de fontes boulonnées et remplies de mortier pour empêcher les infiltrations d’eau. Au moment de leur coulée en fonderie Eiffel a fait intégrer des goussets en fer pour faciliter la fixation des entretoises métalliques.
Comme pour le viaduc de Garabit nous sommes passés sur les tabliers de ces viaducs et avons eu la chance de faire la visite en compagnie d’une harde de chevreuils !
Sylvain Yeatman-Eiffel